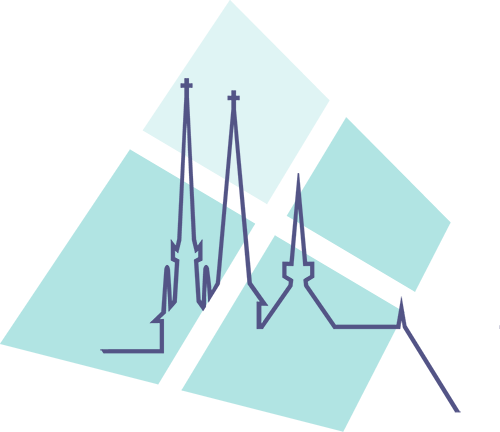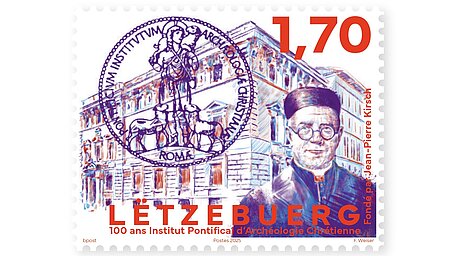![[Translate to Français:] [Translate to Français:]](/fileadmin/_processed_/2/a/csm_1000008060_by_Martin-Fluess_pfarrbriefservice__1__f9f48be33b.jpg)
Position de l’Église catholique sur l’inscription du droit à l’avortement dans la Constitution
La proposition de loi de Déi Lénk visant à inscrire le droit à l’avortement dans la Constitution fait actuellement l’objet de vives controverses entre ses partisans et ses opposants.
Les motivations invoquées pour cette initiative législative sont généralement le droit des femmes à disposer librement de leur corps et la prévention d’une éventuelle restriction des droits des femmes en matière d’interruption de grossesse dans un avenir indéterminé. Les États-Unis et divers pays européens sont cités comme exemples préoccupants à cet égard.
L’Église catholique au Luxembourg s’est prononcée contre l’inscription de l’avortement comme droit fondamental ou comme liberté publique dans la Constitution. Elle maintient cette position pour les raisons exposées ci-dessous.
En effet, chaque être humain possède une dignité inaliénable et irremplaçable, y compris avant sa naissance. La dignité humaine et la protection de la vie sont indissociables.
L’article 12 de la Constitution, qui stipule que « la dignité humaine est inviolable », s’applique également à la vie à naître, qui mérite donc une protection particulière. Jusqu’à présent, l’approche adoptée partait du principe que le fœtus, qui possède un droit à la vie autonome, devait être protégé, ce qui faisait de l’interruption de grossesse une exception dont les conditions et les modalités étaient définies dans un cadre juridique précis.
L’inscription de ce droit ou de cette liberté dans la Constitution entraîne un changement de paradigme éthique et juridique. Le point de départ n’est en effet plus la vulnérabilité et le droit à la vie de l’enfant à naître, perçu et reconnu comme un être à part entière doté de droits propres, mais l’autodétermination de la femme sur son corps, dont l’embryon ne se distingue plus de manière significative en tant qu’être humain à part entière. Le droit à la vie de l’enfant à naître passe donc après le droit à l’autodétermination de la femme.
En cas de conflit lié à la grossesse, deux droits fondamentaux s’opposent : le droit à l’autodétermination de la femme et le droit à la vie de l’enfant à naître. Cette tension est caractéristique du conflit lié à la grossesse, qui est toujours ambivalent.
Si l’on considère l’avortement principalement dans le contexte du droit à l’autodétermination, ce conflit de valeurs est résolu de manière unilatérale.
Les êtres humains sont non seulement des individus autonomes et responsables, mais aussi des êtres relationnels et communautaires, des sujets moraux qui assument une responsabilité non seulement pour leur propre vie, mais aussi pour celle des autres. Si l’on prend cela au sérieux, alors, même dans une société libre et démocratique, il ne peut s’agir uniquement de créer un cadre juridique permettant à chaque individu de réaliser ses propres objectifs de vie de manière autonome.
D’un point de vue sociopolitique et constitutionnel, il est essentiel de garder à l’esprit les intérêts et les droits des femmes enceintes, ainsi que le droit fondamental à la vie des enfants à naître. Concrètement, cela signifie créer un climat social et des conditions-cadres incitant tous les individus à fonder librement et consciemment une famille. Cela implique de nouvelles améliorations de la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, une garde des enfants fondée sur le partenariat, le soutien aux parents isolés, la prévention de la pauvreté infantile et l’égalité des droits dans le monde du travail.
L’inscription d’un droit fondamental à l’avortement dans la Constitution favoriserait la logique du droit du plus fort. Le droit à la vie de l’enfant à naître est alors bafoué. Le risque que l’avortement devienne un moyen de contrôle des naissances est bien réel et se manifeste déjà dans de nombreux endroits.
Il en résulte un conflit avec la « Convention relative aux droits de l’enfant » (Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant), adoptée en 1989 par l’Assemblée générale des Nations unies et ratifiée en 1993 par le Parlement luxembourgeois. L’article 6 de cette convention stipule : « (1) Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie. (2) Les États parties prennent toutes les mesures possibles pour assurer la survie et le développement de l'enfant. »
La convention ne précise pas si le droit à la vie de l’enfant existe avant sa naissance ; il n’a pas été possible de parvenir à une formulation contraignante pour tous les États parties à cet égard. Toutefois, l’obligation mentionnée au paragraphe 2 de garantir « dans toute la mesure possible » la survie et le développement de l’enfant renforce l’obligation de justification qui incombe aux responsables politiques lorsqu’ils souhaitent adopter des dispositions constitutionnelles ou législatives qui ne tiennent guère compte du droit à la vie prénatale de l’enfant.
Les manoeuvres politiques dans d’autres pays constituent une autre justification de cette tentative d'inscription constitutionnelle. Il convient toutefois de comprendre la situation au Grand-Duché avec le recul nécessaire. Au Luxembourg, aucun parti politique ne s’est engagé à affaiblir, voire à abolir, la réglementation en vigueur en matière d’interruption de grossesse. La modification constitutionnelle envisagée ne figure ni dans l’accord de coalition ni dans les programmes électoraux des partis au pouvoir.
Dans ce débat, les points de vue, les arguments et les positions s’opposent (de manière irréconciliable). Une « solution » juridique unilatérale à l’interruption de grossesse ne résout toutefois ni le conflit individuel lié à la grossesse ni les controverses sociales. La Constitution devrait, dans la mesure du possible, refléter le consensus social sur les droits qu’elle entend garantir.
Ce consensus résiderait dans le souhait que les femmes et leurs partenaires confrontés à un conflit lié à la grossesse bénéficient du soutien nécessaire et que la société dans son ensemble y gagne quand elle crée des conditions favorables aux enfants. Ces préoccupations peuvent être prises en compte sans modifier la Constitution.
Merci d'avoir lu cet article. Si vous souhaitez rester informé de l’actualité de l’Église catholique au Luxembourg, abonnez-vous à la Cathol-News, envoyée tous les jeudis, en cliquant ici.
Gros titres
-
D’Mass um 2. Adventssonndeg gëtt vu Miersch iwwerdroen
D'Sonndesmass an de Medien
-
Constantin, une chance pour le christianisme ?
La visite du pape Léon XIV à Nicée a rappelé l’importance de l’empereur Constantin pour l’Église.
-
Op ee Wuert – E Bibel-Podcast
Nei Episode iwwer "Biblesch" Ausdréck, déi an d'Alldaagssprooch iwwergange sinn
-
Podcast: Épisode 11 – Valdemar dos Santos : « La présence de l'Église derrière les murs »
Valdemar, responsable de la pastorale catholique en milieu carcéral, raconte un quotidien fait d’écoute, d’humanité et d’espérance.